Contexte, sources, contenu et postérité d’un classique médiéval de toxicologie.
Rechercher dans blog
Derniers articles

À la charnière des Lumières et du romantisme naissant, une immense curiosité pour le monde parcourt l’Europe. Les...
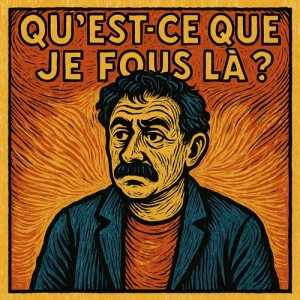
Il avait ce coup de crayon inimitable, ce regard qui saisissait la drôlerie du monde sans en atténuer la cruauté. Né...


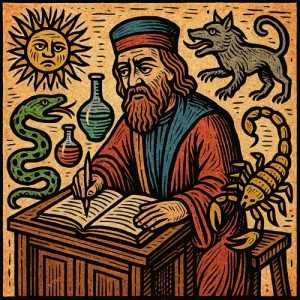

![[37] Descartes - Place Descartes (épreuve photo)](https://abao.be/bouquinerie/3280-home_default/-37-descartes-place-descartes-epreuve-photo.jpg)
![[45] Nogent-sur-Vernisson - Photographie de Guy Laforgerie. N°69KM20.](https://abao.be/bouquinerie/15318-home_default/-45-nogent-sur-vernisson-photographie-de-guy-laforgerie-n69km20.jpg)

![[1914-1918] Album de photographies «Belgian War Mission New York August 1917»](https://abao.be/bouquinerie/16287-home_default/-1914-1918-album-de-photographies-belgian-war-mission-new-york-august-1917.jpg)


![[Cinéma] Photographie de Liza Minelli et Robert De Niro.](https://abao.be/bouquinerie/36718-home_default/-cinema-photographie-de-liza-minelli-et-robert-de-niro.jpg)
![[Cinéma] Photographie de Robert De Niro.](https://abao.be/bouquinerie/36724-home_default/-cinema-photographie-de-robert-de-niro.jpg)
Laissez un commentaire
Connectez-vous pour publier des commentaires